 |
LE Théâtre |
|
|
|
Le Théâtre a été édifié à flanc de colline en limite sud de l'agglomération, à proximité de la voie romaine Poitiers-Tours, vers le milieu du Ier siècle de notre ère. Aujourd'hui, une tour de 14 mètres de hauteur inscrit sa silhouette dans le paysage et demeure le témoin d'une architecture grandiose. Les premières recherches réalisées par M. Delavau de la Massardière sur le site de Vieux-Poitiers remontent au milieu du XIXe siècle et ont porté sur l'environnement proche de la tour. Il fallu attendre les fouilles conduites au début du siècle suivant par E. Ginot et F. Eygun pour reconnaître les vestiges d'un vaste théâtre gallo-romain. |
|
La tour et les blocs architecturaux découverts évoquent le caractère monumental de l'édifice. Jusqu'en 1810 ou 1811, non loin de la tour se dressaient encore les ruines imposantes de la partie orientale du mur de scène dont on possède une gravure du XIXe siècle. Il s'agissait d'un mur parementé comme la tour , de 2 mètres d'épaisseur, conservé sur 9 ou 10 mètres de long et 5 de haut. Sur la face nord se succédaient quatre arcs aveugles. |


|
|
|
C'est principalement sur le théâtre qu'ont porté les investigations archéologiques menées par R. Fritsch et son équipe (Société des Sciences de Châtellerault) entre 1963 et 1986. Elles ont permis de dégager le tiers sud-est de l'édifice et de proposer les grandes étapes de l'évolution architecturale de l'édifice. La reprise des fouilles en 1995, dans le cadre d'un projet de mise en valeur contribua à préciser le plan du théâtre et sa chronologie dont les premiers éléments avaient été établies à l'issue des recherches menées par R. Fritsch et son équipe. |
|
|

|
Conformément aux théâtres de type gallo-romain, l'édifice de Vieux-Poitiers, de 116 mètres de diamètre présente une orchestra en demi-cercle outrepassé dans laquelle s'avance le bâtiment de scène aux dimensions très réduites. Les structures maçonnées de la cavea, les murs rayonnant et les galeries concentriques servaient d'assises aux gradins en bois dont les clous de fixation ont été retrouvés en masse au cours des fouilles. Dans la partie supérieure de la cavea, l 'une de ces galeries, le maenianum assurait la division en deux niveaux de gradins et jouait sans doute un rôle dans la répartition des visiteurs. Notre connaissance concernant la circulation des spectateurs au sein de l'édifice et la restitution éventuelle des volumes architecturaux reste toutefois lacunaire. Ceci est lié d'une part à la complexité du théâtre et d'autre part aux nombreuses transformations qui suivirent un voire plusieurs foyers d'incendie peu avant le milieu du IIe siècle. Ces transformations ont concerné l'orchestra et le dispositif scénique. Certains murs de la cavea dont le maenianum ont également été transformés et consolidés. Les dernières investigations de terrain ont mis en évidence la disparition tout au moins partielle du décor architectural du premier état.
|
|
|

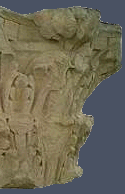
|
Chapiteau corinthien probablement issu du décor de la frons scenae. |
| Même si le bâtiment et son système de circulation furent transformés, l'édifice ne perdit pas sa fonction d'origine d'autant que des aménagements découverts lors des dernières investigations au bas de la cavea prouvent la présence d'une proédrie dans le second état du monument. A l'instar de nombreux édifices publics en Gaule et en particulier des théâtres, l'entrée dans le IIIe siècle marque un coup d'arrêt au fonctionnent de l'édifice de Vieux-Poitiers. Au milieu du siècle, le bâtiment est investi par des habitats précaires probablement en relation avec le travail de récupération des matériaux de construction du théâtre. |
|
|



